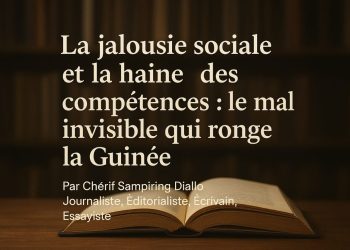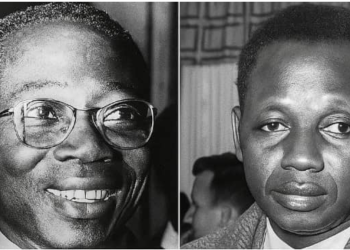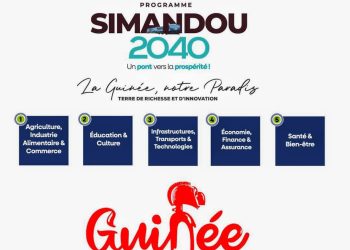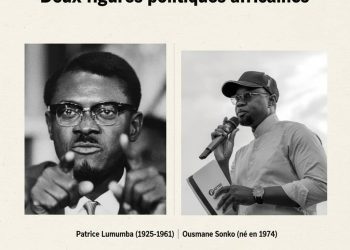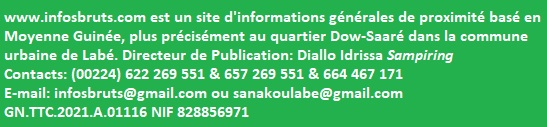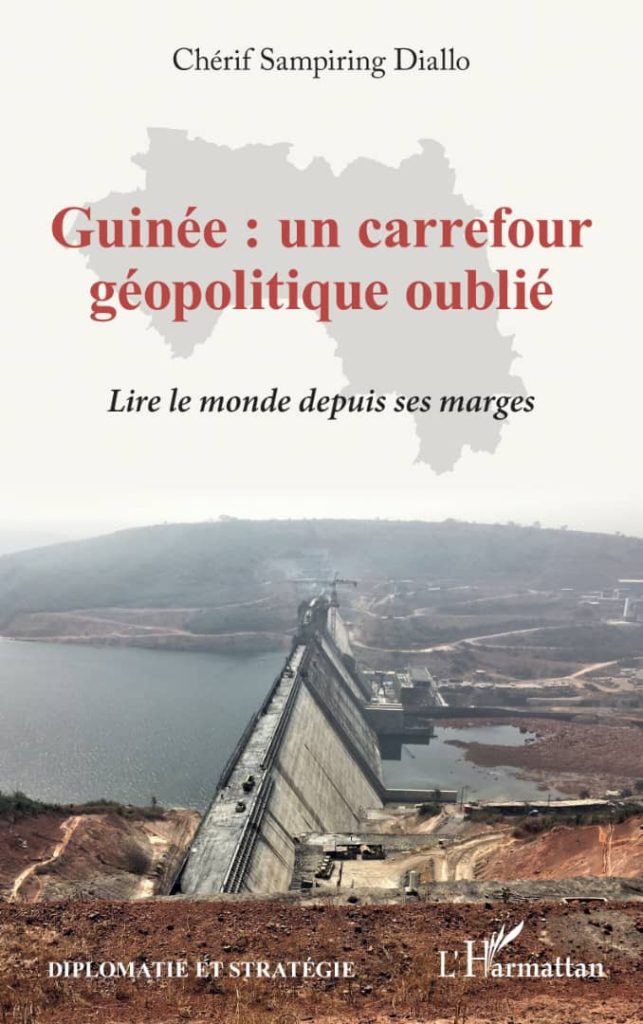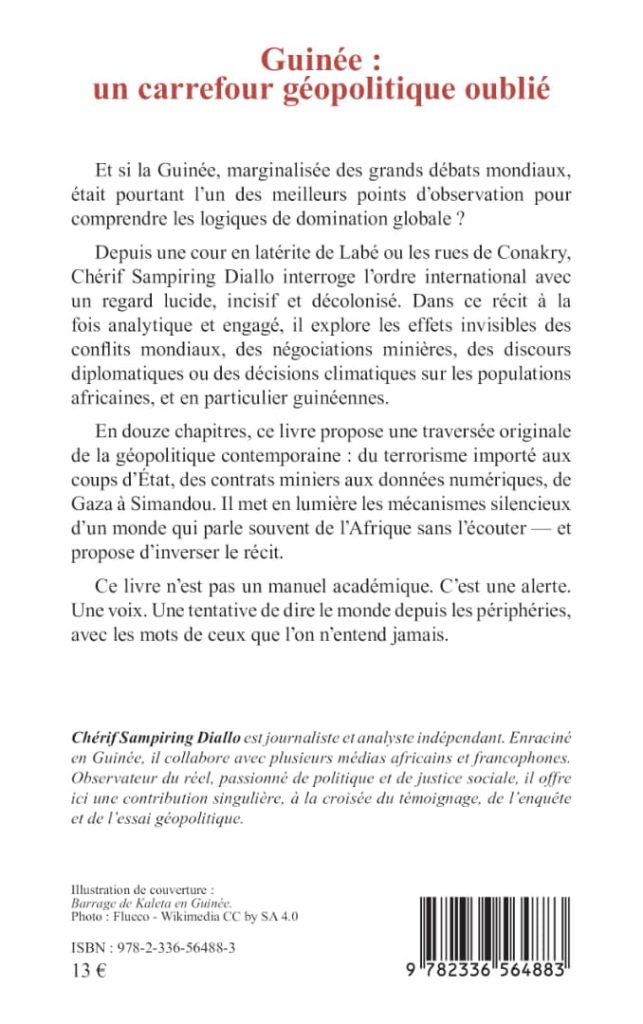Guinée, 6 nov (Infosbruts.com) – Il existe, dans la vie sociale, professionnelle ou religieuse, un phénomène aussi discret que redoutable : celui des auto-restrictions, ces règles invisibles qu’on s’impose au nom d’un prétendu « professionnalisme », d’une « tradition » ou d’un « usage », sans jamais pouvoir en démontrer le fondement juridique, déontologique ou même rationnel.
Ce sont des normes sans textes, des interdits sans origine, des croyances sans Écriture. Elles se propagent par mimétisme, se consolident par habitude et finissent, à force d’être répétées, par acquérir la force d’une loi.
Dans certains milieux professionnels, on entend souvent dire : « cela ne se fait pas », « ce n’est pas professionnel », « ici, ce n’est pas l’usage ». Mais lorsqu’on demande quelle règle, quel code, quel article de loi fonde cette interdiction, le silence s’installe.
C’est le règne du non-dit érigé en norme. Le professionnel véritable, pourtant, ne s’en remet pas à des coutumes fluctuantes : il se réfère à la déontologie, c’est-à-dire à un ensemble de principes écrits, vérifiables et universalisables, qui encadrent la pratique de son métier.
En confondant « usage » et « règle », beaucoup oublient que la déontologie n’est pas la coutume, mais la raison normée.
Ce glissement de la norme vers la pratique n’est pas anodin : il traduit une forme de paresse intellectuelle ou de conformisme social. L’« usage » devient un refuge commode pour ceux qui ne veulent pas penser les fondements de leurs actes.
C’est ainsi que, dans certains environnements, l’innovation, la liberté de ton ou la pensée critique sont perçues comme des écarts, non parce qu’elles violent une loi, mais parce qu’elles bousculent une routine.
Le conservatisme se déguise alors en rigueur professionnelle, et la peur du changement se pare des atours du sérieux.
Le phénomène dépasse le cadre professionnel.
On le retrouve dans la politique et la religion, deux domaines où la parole des hommes se substitue souvent à la lettre des textes. Combien de fois entend-on, avec assurance, qu’une transition politique « ne doit pas durer plus de deux ans » ? Mais qui a jamais écrit cela ? Dans quelle constitution, dans quel traité, dans quelle jurisprudence internationale cette règle est-elle formulée ? Nulle part. C’est une invention de circonstances, née d’intérêts particuliers, ensuite sacralisée comme principe universel. L’usage politique, ici encore, se déguise en loi naturelle.
Il en va de même pour certaines interprétations religieuses. On affirme, par exemple, qu’il est « interdit pour un musulman d’épouser sa copine ». Mais où cela est-il écrit ? Nulle part. Ce qui est explicitement interdit, c’est d’avoir une relation amoureuse hors mariage.
Autrement dit, l’interdiction ne concerne pas le mariage, mais le comportement antérieur au mariage. En confondant le moral et le juridique, certains transforment un précepte de conduite en une règle de droit, au risque de déformer le sens même du texte religieux.
Ces auto-restrictions révèlent une pathologie culturelle : la substitution de l’usage à la loi, du réflexe à la raison, du « on dit » au « on sait ». Elles prospèrent dans les sociétés où la parole d’autorité remplace la preuve, où le prestige social vaut plus que le texte, où la coutume s’impose comme vérité. Ce n’est pas la rigueur qui en découle, mais l’immobilisme.
Être professionnel, être intellectuel, être croyant même, ce n’est pas répéter sans comprendre. C’est interroger, vérifier, penser. L’esprit critique n’est pas l’ennemi de la règle, il en est la garantie. Une société qui s’interdit de questionner ses usages devient prisonnière de ses automatismes.
Ainsi, le véritable professionnalisme ne se mesure pas à la fidélité à des usages obscurs, mais à la capacité de fonder chaque geste sur une raison, chaque principe sur un texte, chaque norme sur une légitimité.
L’intellectuel, lui, n’obéit pas à l’usage : il le questionne. Car ce n’est pas l’usage qui fait l’homme libre, mais la conscience éclairée de ce qui fonde la règle.