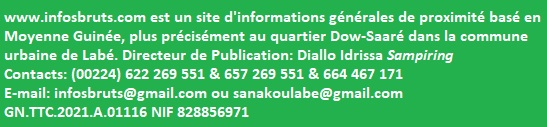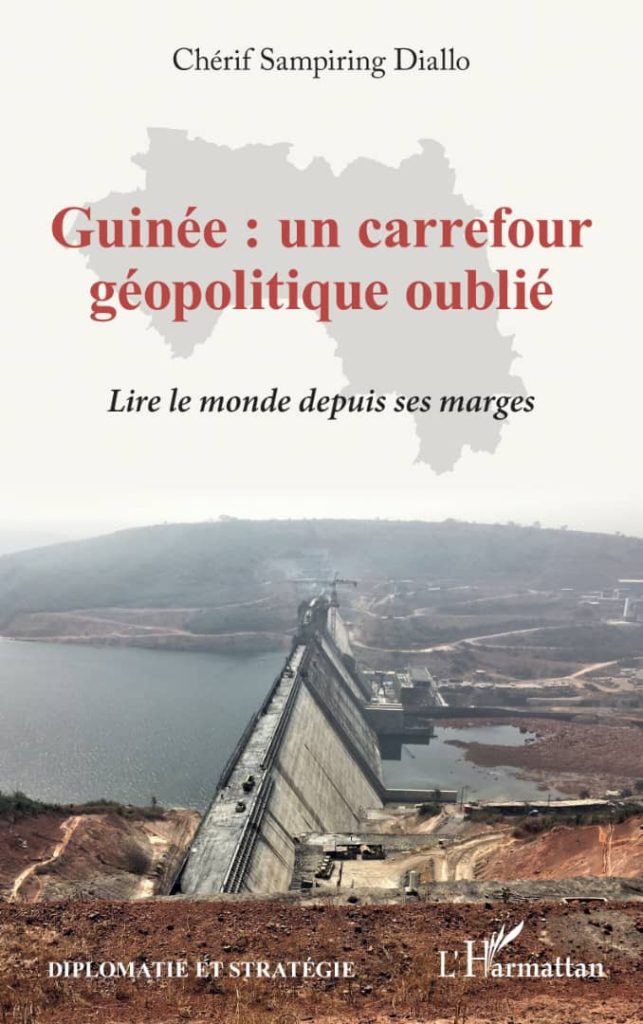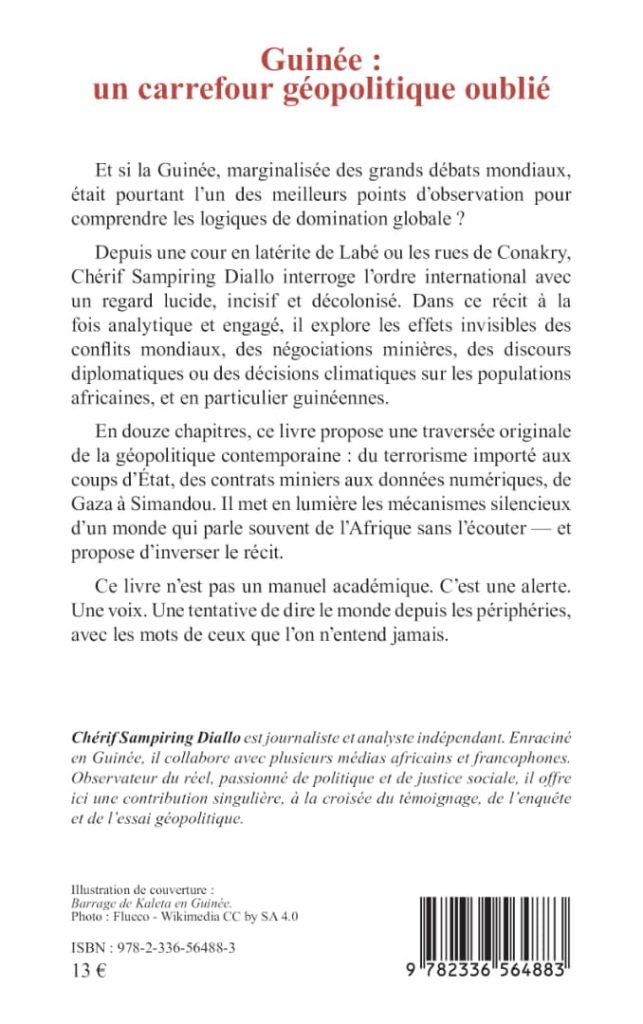Guinée, 12 août (Infosbruts.com) – En sciences politiques, un principe fondamental veut que la crédibilité d’un acteur se mesure autant à son parcours qu’à ses positions actuelles. C’est à l’aune de ce principe que l’on doit analyser les propos de Cellou Dalein Diallo, lorsqu’il qualifie la transition conduite par le Général Mamady Doumbouya de “dérive dictatoriale”.

Un acteur façonné par le système qu’il dénonce
De décembre 2004 à avril 2006, Dalein occupe la primature dans un contexte institutionnel verrouillé. Sa destitution, consécutive à une tentative d’élargir ses prérogatives par décret, traduit moins une audace réformatrice qu’un conflit de pouvoir mal calibré. Dans la logique institutionnelle, cet épisode révèle une absence de stratégie pour infléchir durablement les rapports de force au bénéfice de la gouvernance démocratique.
L’épreuve manquée de 2007 : un indicateur éthique
La grève générale de janvier-février 2007, épisode majeur de la contestation sociale en Guinée, se solde par plus de 130 morts. Les théories de l’engagement politique (cf. Hirschman, 1970) distinguent “exit” et “voice” comme stratégies de réaction. Dalein choisit le retrait, ni positionnement public fort, ni médiation active, là où un leader crédible aurait dû opter pour une prise de parole en faveur des libertés civiques.

L’opposition à géométrie variable
En politologie, on appelle “opposition de confirmation” (confirmation opposition) une attitude consistant à ne reconnaître la légitimité d’un processus électoral que lorsque son issue est favorable. Les boycotts répétés (législatives 2020, référendum 2020) et le rejet systématique des résultats défavorables (présidentielles 2010, 2015) inscrivent Dalein dans ce schéma. La loi n’est, dans ce cadre, qu’un instrument lorsqu’elle protège ses intérêts, et une entrave lorsqu’elle lui est défavorable.
Doumbouya : rupture stratégique avec le statu quo.
À son arrivée en 2021, Mamady Doumbouya hérite d’un État où les institutions sont décrédibilisées par des décennies de fraudes électorales et de clientélisme politique. La théorie de la transition (O’Donnell & Schmitter, 1986) indique que dans un contexte post-crise, la consolidation institutionnelle prime sur la libéralisation absolue. Les audits de gestion, l’inclusion de la société civile dans le processus constitutionnel, et la refonte des bases juridiques visent précisément cet objectif.
Les restrictions : sécurité ou autoritarisme ?
Les mesures de contrôle des médias et de limitation des manifestations, observées depuis 2021, relèvent davantage d’une logique de “stabilisation préventive” (Linz & Stepan, 1996) que d’une installation dans l’autoritarisme. Elles visent à éviter la “repolarisation conflictuelle” typique des transitions avortées. Dalein, par son expérience gouvernementale, connaît la complexité de ces arbitrages, mais choisit de les qualifier uniquement sous l’angle répressif.
Le paradoxe mémoriel.
Assimiler la transition actuelle à une dictature revient à ignorer la différence analytique entre un régime autoritaire consolidé et un régime transitoire à contraintes sécuritaires. Plus encore, cela occulte la participation passée de Dalein à des gouvernements où la répression et le verrouillage institutionnel étaient structurels, sans qu’il en fît une cause publique majeure.
Conclusion
En démocratie, la critique est légitime, mais elle exige la cohérence historique. Or, la posture actuelle de Dalein relève moins d’une défense universelle des libertés que d’une stratégie de conquête du pouvoir, adossée à une mémoire sélective. Face à cela, la démarche de Doumbouya, bien qu’imparfaite, s’inscrit dans un cadre théorique de refondation institutionnelle, où la priorité est donnée à la consolidation avant la compétition.
« Les faits sont têtus, même en politique. »
Chérif Sampiring Diallo, Éditorialiste, InfosBruts.com
« Une plume au service de la Guinée « .