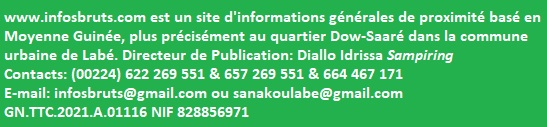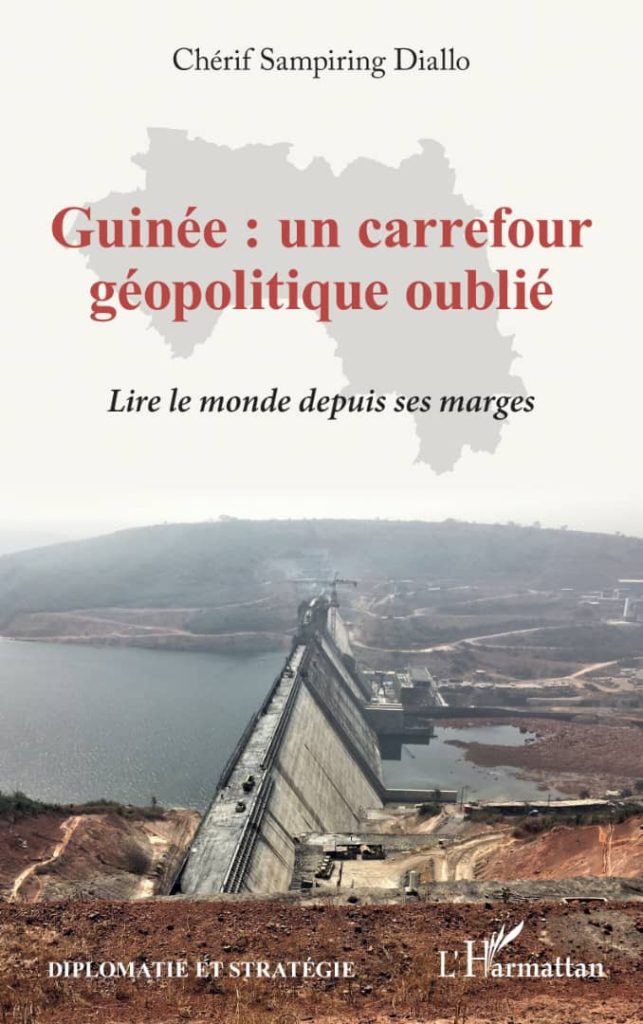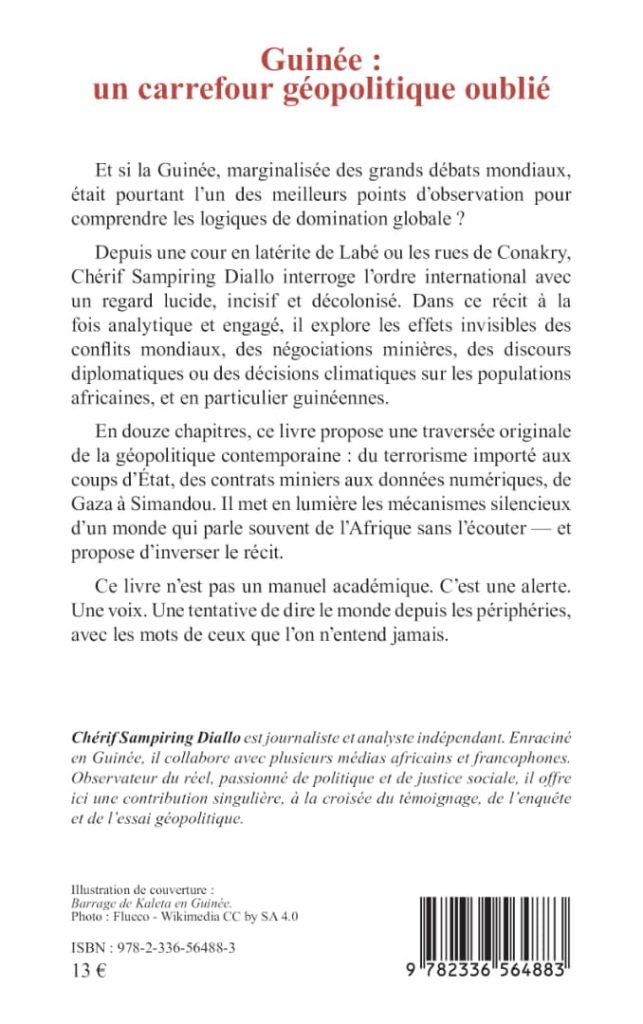Guinée, 12 juillet (Infosbruts.com) – Alors que la jeunesse constitue la majorité démographique de la Guinée, elle reste paradoxalement la minorité la plus sous-représentée dans les processus de décision.

Trop souvent, les politiques publiques échouent à répondre à ses attentes parce qu’elles partent d’un postulat erroné : que les jeunes seraient désengagés, passifs, voire inaptes. Mais si le véritable problème n’était pas la jeunesse elle-même, mais le monde qu’on lui a légué ? Un monde en déséquilibre, à moitié brûlé, à moitié verrouillé, dans lequel on lui demande de réussir, sans jamais lui avoir transmis les clés pour comprendre les règles du jeu.
On Invite les jeunes à rêver grand, à être ambitieux, libres, responsables. Mais en parallèle, on leur apprend à se taire, à se conformer à des modèles rigides, à entrer en compétition dès l’enfance, à imiter plutôt qu’à innover. Ce décalage constant crée un vertige générationnel : une forme de désorientation silencieuse, où l’individu doute de lui, non pas par manque de volonté, mais par épuisement face à un système qui ne le reconnaît pas.
Dans nos sociétés, beaucoup de jeunes brillants stagnent dans des emplois alimentaires sans perspective. D’autres regorgent d’idées, mais manquent d’accès aux réseaux ou aux ressources pour les concrétiser. Certains fuient les responsabilités, non pas par paresse, mais par peur de l’échec ou du jugement. La pression sociale pousse à l’apparence, on performe sur les réseaux, on se construit une façade pendant que les blessures intérieures s’approfondissent dans le silence.
Cette réalité n’est pas marginale : elle est généralisée. Elle traverse les classes sociales, les territoires, les niveaux d’instruction. Elle révèle un fait inquiétant : la fracture générationnelle n’est pas seulement économique, elle est existentielle.
Développement : une approche encore trop verticale
Les stratégies de développement restent dominées par des approches descendantes, techniques, souvent déconnectées des réalités du terrain. On investit dans les infrastructures sans construire les imaginaires collectifs. On parle d’emploi des jeunes sans écouter ce qu’ils ont à dire sur le travail. On parle d’autonomisation sans créer d’espaces de confiance, d’apprentissage et d’expérimentation.
Or, pour qu’un développement soit durable, il doit d’abord être désirable. Et pour qu’il soit désirable, il doit être co-construit avec celles et ceux qui en sont les premiers bénéficiaires notamment les jeunes.
Répondre au besoin fondamental retrouver du sens :
La génération actuelle est saturée d’informations, mais en manque de sens. Elle est hyperconnectée, mais profondément en quête de lien humain. Elle est témoin de multiples récits de réussite, mais n’a que peu d’exemples d’effort, de résilience, ou d’authenticité. Cette crise du sens est l’un des plus grands défis pour les politiques publiques en matière de jeunesse.
Nous devons désormais repenser l’insertion, non pas comme un simple processus de placement ou de subvention, mais comme un parcours d’appropriation identitaire, sociale et citoyenne. Il s’agit de donner aux jeunes des espaces où échouer est permis, où apprendre à son rythme est légitime, où penser différemment est valorisé. Il s’agit aussi de revoir les modèles d’accompagnement, de mentorat et de gouvernance pour inclure la jeunesse dans les dynamiques de co-construction et de pilotage.
Et maintenant, que faire ?
Il ne s’agit plus simplement de consulter les jeunes, mais de les considérer comme des partenaires à part entière dans la construction du développement.
Il faut :
Mettre en place des mécanismes permanents de dialogue intergénérationnel.
Créer des espaces physiques et numériques où les jeunes peuvent proposer, tester, échouer, recommencer.
Valoriser les compétences dites « non formelles » : créativité, empathie, résilience, intelligence émotionnelle.
Décloisonner l’éducation, la formation et l’entrepreneuriat pour faciliter les parcours hybrides et adaptables.
Conclusion : faire confiance pour faire émerger
La jeunesse n’est pas une bombe à désamorcer, c’est une énergie à canaliser. Elle ne demande pas l’aumône, mais l’écoute, la clarté, les moyens d’agir. L’erreur serait de continuer à voir les jeunes comme des “bénéficiaires”. Ils sont déjà des acteurs. Encore faut-il leur faire une vraie place, sans condition de conformité.
Le vertige qu’ils ressentent n’est pas un caprice, c’est un signal. Il nous indique que le développement ne peut plus se penser sans eux et surtout, pas sans leur réalité.
Biographie : Ismael Sowtall est un communicant et acteur de l’innovation sociale, lauréat de plusieurs prix dans le domaine de l’innovation. Il œuvre à faire émerger des solutions locales au service du développement durable et de la jeunesse.





![Sports: « Karifamoriah Football Club [KFC] écrit une belle page de l’histoire du football guinéen ». (Par Mamady Kansan Doumbouya).](https://www.infosbruts.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250917-WA0219-350x250.jpg)